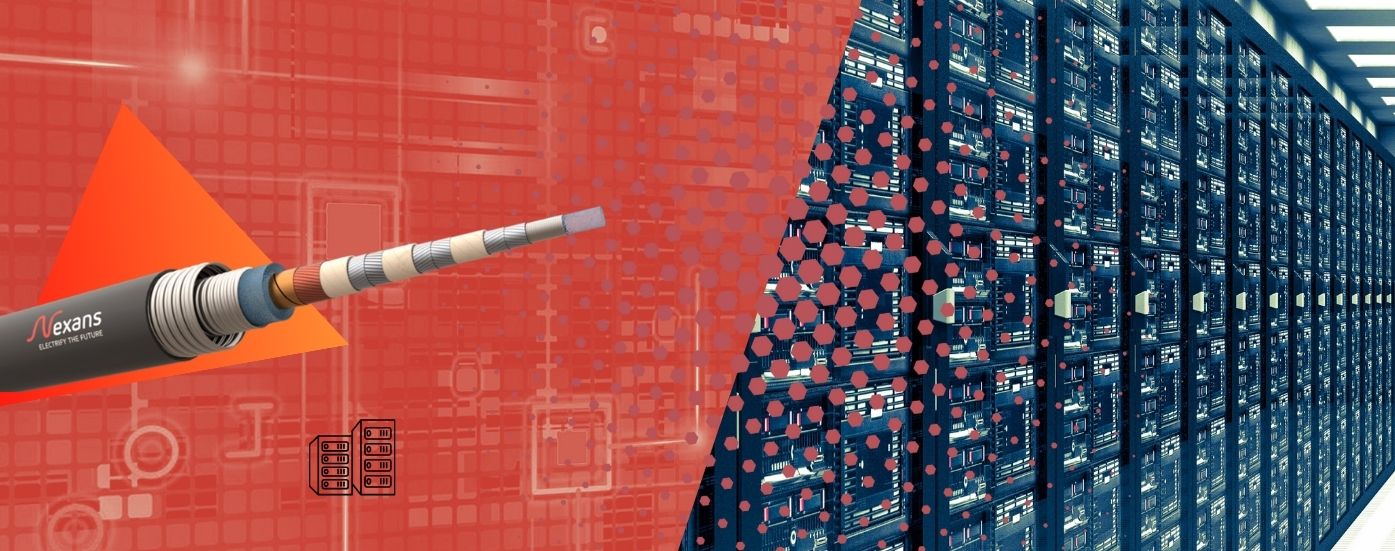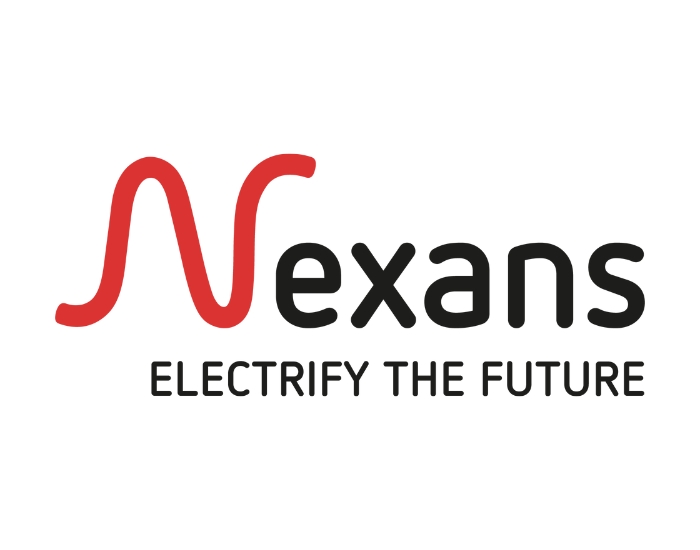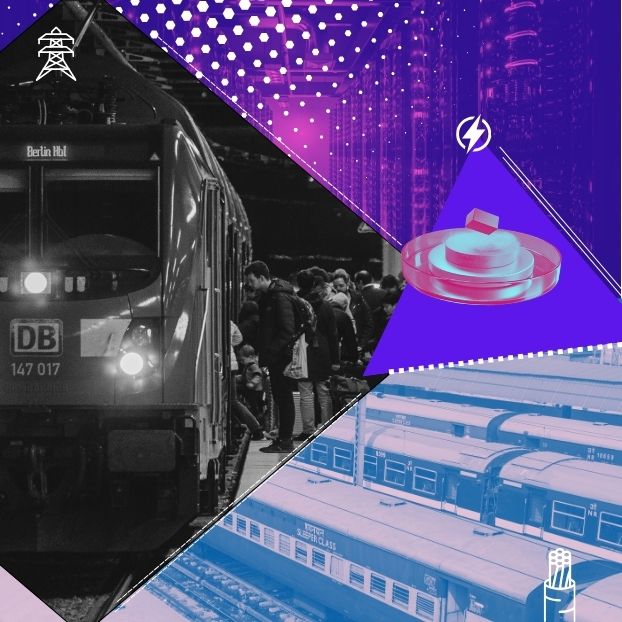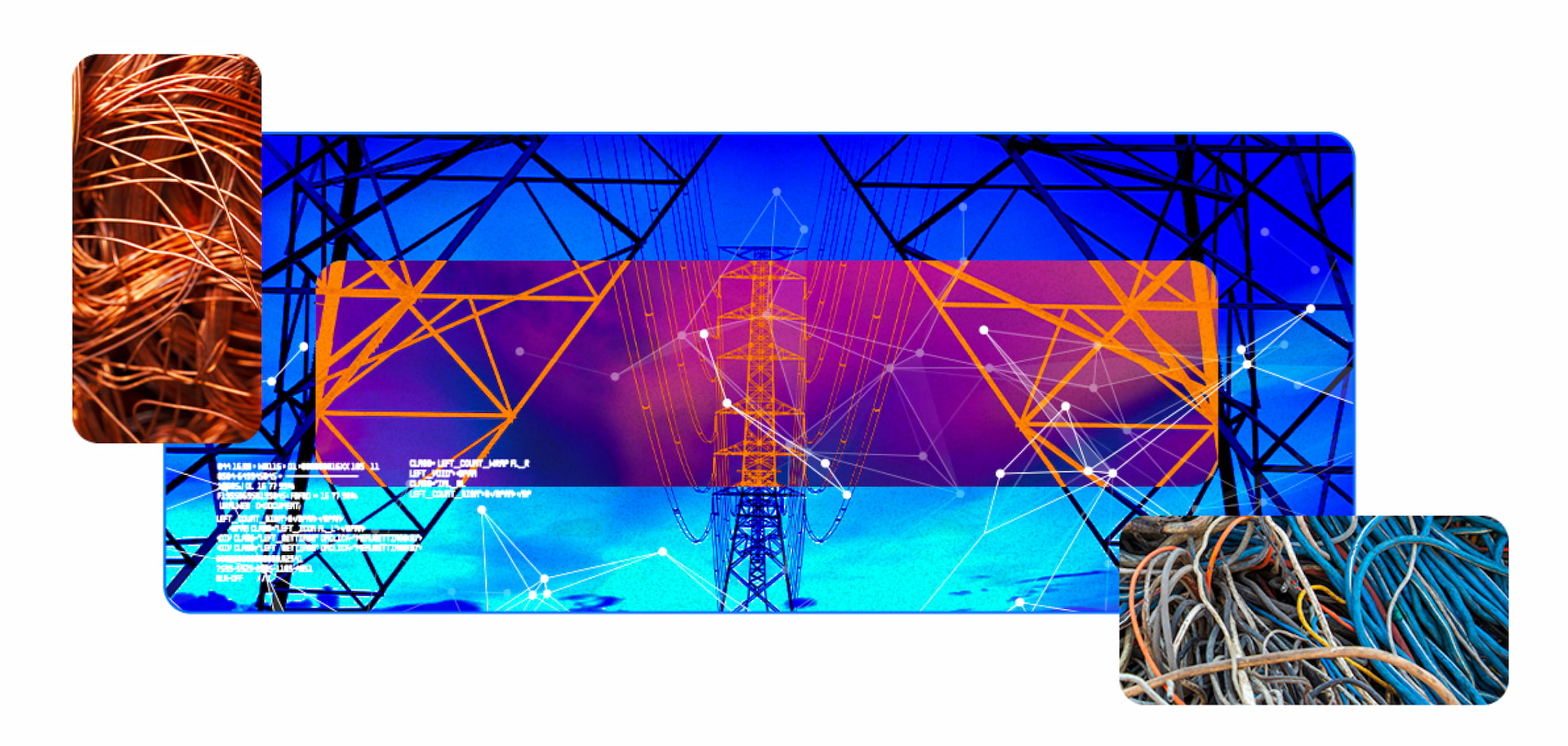Gérer les charges extrêmes et la demande énergétique
Les réseaux ferroviaires connaissent des pics d’activité aux heures de pointe ; les data centers, eux, doivent absorber des charges de calcul intensives. Tous deux nécessitent une gestion fine de la charge, un pilotage en temps réel de l’énergie et un contrôle rigoureux de la qualité de l’alimentation.
Les câbles supraconducteurs à haute température (HTS) répondent à ces exigences grâce à leurs capacités de transmission exceptionnelles. Jusqu’à dix fois plus compacts que les câbles classiques, ils réduisent l’emprise au sol et les coûts d’installation, tout en supprimant totalement les pertes d’énergie.
Un seul câble supraconducteur peut acheminer plus de 2 GW en courant alternatif et plus de 3 GW en courant continu, dans une tranchée d’à peine cinquante centimètres de large. Cette conception compacte se révèle précieuse en milieu urbain, où le foncier est rare et coûteux. Un câble HTS de 15 kV en courant alternatif peut transmettre plus de 100 MVA à des niveaux de distribution — un avantage concurrentiel majeur.
Au cœur des salles de données, les câbles supraconducteurs à fort courant et basse tension permettent de gagner jusqu’à 24 fois plus d’espace que les solutions conventionnelles. Leur conception ultra-compacte garantit une densité de courant très élevée, des pertes de transmission quasi nulles et une empreinte globale considérablement réduite.
Garantir la fiabilité et la redondance
Dans les deux secteurs, l’exploitation en continu ne souffre aucun compromis : le moindre arrêt se traduit par des retards, des pertes de données, des pannes de système, voire des risques pour la sécurité. Les centres de données d’intelligence artificielle exigent une disponibilité dite « five nines » — soit 99,999 % de temps de fonctionnement —, tandis que les réseaux ferroviaires recherchent une redondance équivalente pour garantir des départs et arrivées parfaitement ponctuels. La redondance désigne la mise en parallèle de plusieurs alimentations. Une configuration qui permet d’alimenter en continu la chargée connectée même en cas de défaillance d’une source.
Les systèmes de câbles supraconducteurs intègrent une redondance complète, à la fois dans le câble HTS (haute température) et dans le dispositif de cryo-refroidissement. Le maintien d’une charge équilibrée assure la continuité du service et répond aux plus hauts standards de fiabilité opérationnelle.
Les limiteurs supraconducteurs de courant de défaut offrent une protection supplémentaire essentielle : ils réduisent automatiquement les surintensités sans interrompre le service. Cette technologie protège les transformateurs et les disjoncteurs, tout en renforçant la stabilité du réseau, la qualité de l’alimentation et la fiabilité globale du système.
Résoudre les défis de conversion électrique
Les câbles supraconducteurs en courant continu suppriment les conversions inutiles entre les sources renouvelables et les applications finales, évitant ainsi la complexité et les pertes attribuables à l’électronique de puissance traditionnelle.
Cependant, les deux secteurs restent fortement dépendants de ces équipements, notamment pour la conversion du courant alternatif en courant continu via des onduleurs ou des convertisseurs. Le contrôle des harmoniques et le filtrage sont donc essentiels pour garantir la qualité du courant. Par ailleurs, les câbles supraconducteurs n’émettent aucun champ électromagnétique : une solution sûre, stable et sans interférences.
Optimiser le refroidissement et la gestion thermique
Les opérations de refroidissement des composants électroniques de traction, des sous-stations, des serveurs, des batteries et des systèmes UPS présentent des défis permanents pour réduire la consommation d’énergie et atteindre des normes de performance plus élevées.
En comparaison aux câbles résistifs conventionnels, les câbles supraconducteurs sont plus compacts et ne génèrent pas de chaleur. Ces derniers éliminent ainsi le besoin de refroidissement supplémentaire tout en réduisant la charge électrique associée et les émissions de CO₂. Un avantage qui évite ainsi la surchauffe et minimise le gaspillage d’énergie.
Accélérer l’intégration des énergies renouvelables
L’intégration des énergies renouvelables stimule depuis plusieurs années les investissements, avec une utilisation croissante du solaire et de l’éolien dans les gares, dépôts et centres de données — souvent complétée par des installations photovoltaïques sur site et des systèmes de stockage d’énergie par batteries. L’interaction avec les réseaux intelligents, incluant la gestion de la demande, le transfert de charge et l’écrêtement des pics de consommation, se généralise.
La supraconductivité constitue une véritable révolution pour cette intégration. L’association des câbles HTS et du courant continu résout le paradoxe des énergies renouvelables : nous savons produire une énergie propre, mais peinons à la transporter efficacement jusqu’aux zones de forte demande. Les parcs solaires et éoliens se situent souvent loin des centres urbains, et chaque kilowatt perdu en route impose de brûler davantage de combustibles fossiles pour compenser.
Les câbles supraconducteurs en courant continu permettent d’acheminer d’importants courants à basse tension sur plusieurs kilomètres, sans aucune chute de tension — une solution idéale pour relier les sites de production éloignés aux zones urbaines consommatrices.
Cette capacité ouvre la voie à des systèmes énergétiques entièrement décarbonés et modulaires, grâce aux Uninterrupted Power Plants (UPP ou centrales électriques ininterrompues) : des micro-réseaux modulaires intégrant des boucles en courant continu basse tension à câbles supraconducteurs à haute température, pour une fiabilité maximale et un fonctionnement autonome, sans dépendance au réseau principal. Les réseaux ferroviaires comme les centres de données peuvent ainsi fonctionner sur des micro-réseaux 100 % renouvelables, supprimant tout recourt aux sources fossiles et atteignant une neutralité carbone réelle.
Les câbles supraconducteurs transmettent le courant continu sans aucune perte, ce qui en fait la solution idéale pour les panneaux solaires fonctionnant à 1 500 volts en courant continu. Ils assurent une livraison d’énergie optimale, maximisent le rendement des voies ferrées et des salles de données, et s’adaptent parfaitement aux systèmes de stockage BESS, où le courant continu est transmis de manière efficiente grâce à la technologie HTS.
Optimiser la consommation énergétique
La pression croissante des pouvoirs publics et des régulateurs pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone pousse les industriels à repenser leurs infrastructures électriques et à concevoir des systèmes plus performants, articulés autour de trois leviers majeurs :
- L’optimisation énergétique intelligente, combinant la distribution en courant alternatif et en courant continu.
- Les jumeaux numériques pour la simulation et la modélisation énergétique, avec l’adoption de technologies de réseau innovantes. La supraconductivité fait partie de ces avancées majeures qui participent à la modernisation des infrastructures électriques.
- La conception modulaire pour faciliter le dimensionnement énergétique et l’isolation des défauts. Les limiteurs supraconducteurs de courant de défaut s’imposent de plus en plus comme une solution clé. Ils permettent le fonctionnement automatisé des postes électriques, sans intervention humaine en cas d’incident, tout en offrant une protection optimale des équipements du réseau.