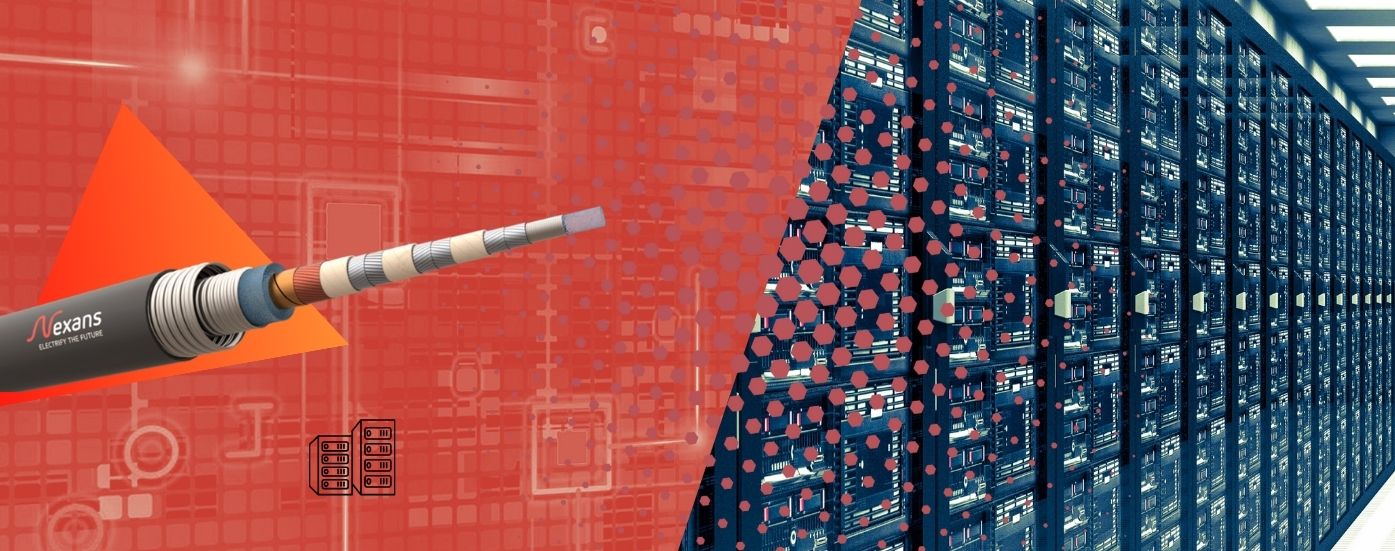Répondre aux besoins d’un monde numérique en pleine expansion
Depuis 2010, le nombre d’utilisateurs d’internet dans le monde a plus que doublé – 5,5 milliards utilisateurs d’internet en 2024, tandis que le volume du trafic en ligne a été multiplié par vingt-cinq. Véritable colonne vertébrale de l’économie numérique, les data centers se sont développés à un rythme sans précédent. Pourtant, leur mode d’alimentation énergétique n’a pas évolué au même rythme que leurs usages.
Imaginez vouloir relier deux villes éloignées avec une simple locomotive, alors qu’il vous faudrait un train à grande vitesse. C’est exactement le défi auquel sont confrontés les data centers modernes : devenus de véritables usines à données. Ces infrastructures qui consommaient autrefois quelques dizaines ou centaines de mégawatts franchissent désormais le seuil du gigawatt, atteignant des niveaux comparables à ceux de l’industrie lourde. Cette montée en puissance met à rude épreuve les systèmes d’alimentation traditionnels à base de cuivre, obligeant les opérateurs à consacrer toujours plus d’espace, de refroidissement et de capitaux à leurs réseaux internes plutôt qu’à la puissance de calcul.
Jusqu’à présent, les gains d’efficacité ont permis de contenir la consommation énergétique totale des data centers entre 1 et 1,5 % de la demande mondiale. Mais si la tendance se poursuit, cette part pourrait grimper à 10 % d’ici 2030. Pour accompagner cette croissance de manière durable tout en maintenant un taux de disponibilité de 99 %, il est nécessaire de repenser en profondeur la distribution électrique interne.